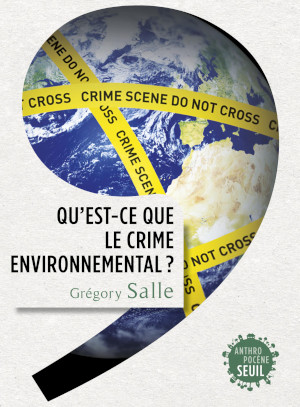Acrimed — On sait que le traitement médiatique de la question environnementale en général « n’est pas à la hauteur des enjeux », comme l’exprimaient par exemple des associations de journalistes spécialisés en janvier. Dans le premier chapitre de Qu’est-ce que le crime environnemental ?, tu t’intéresses à l’un des aspects de cette question. Et le premier constat que tu fais, quelle que soit l’acception du concept de « crime environnemental » (à grands traits : une acception juridique qui prend en compte les atteintes illégales à l’environnement vs une acception sociologique qui inclut aussi certaines atteintes légales), c’est celui de la « rareté des sujets qui sont consacrés » au « thème de la délinquance ou de la criminalité environnementale au cours des dernières décennies ». Peux-tu présenter ta méthode de comptage et l’idée qui la guide ?
Grégory Salle — À vrai dire, ce comptage est fait lui aussi « à grands traits » ! Dans le cadre de cet essai, je me suis contenté de présenter les grandes lignes, de donner des ordres de grandeur, qui restent à affiner. L’idée de départ, c’était de vérifier l’impression selon laquelle des notions comme « délinquance écologique » ou « criminalité environnementale » n’avaient pas réussi à s’imposer dans le débat public, en tout cas qu’elles n’étaient pas d’usage courant ou régulier dans le discours médiatique. A priori leur « potentiel de succès » ne paraît pas mince… Et il y a bien des termes qui, en quelques années, deviennent quasiment incontournables, pour le meilleur et pour le pire (« résilience »…). Pourquoi donc cet insuccès ?
La méthode est classique : il s’agit de constituer et d’exploiter un corpus, c’est-à-dire un ensemble de textes établi systématiquement à partir de critères déterminés. Trois corpus en l’occurrence : un pour la presse écrite, un autre pour la radio et un dernier pour la télévision. Pour la presse écrite, c’est devenu assez facile, car il existe des bases de données spécialisées donnant accès au contenu des principaux titres. On peut donc constituer des corpus à partir de mots-clés, comme « délinquance écologique », « crimes environnementaux » ou « écocriminalité ». Il y a évidemment des limites, notamment l’accès réduit à certains supports dominés dans le — et situés à gauche du — champ journalistique, alors même qu’ils sont en général en pointe sur le sujet. Tout dépend évidemment de la zone du champ que l’on cherche à couvrir. Pour la radio et la télévision, on bénéficie des fonds (le « dépôt légal ») de l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Outre le catalogue en ligne, qui offre déjà la possibilité de travailler de l’extérieur, les antennes régionales de l’INA proposent des outils permettant d’aller plus loin, en commençant par l’écoute ou le visionnage des programmes concernés.
On peut alors effectuer une analyse, statistique ou plus « littéraire », de ces corpus. C’est-à-dire étudier à la fois la couverture médiatique (qui en parle et quand, pour le dire vite) et le traitement médiatique (comment on en parle quand on en parle), d’un point de vue quantitatif et/ou qualitatif. Il n’y a pas de représentation graphique dans le livre, sous forme d’histogrammes ou de courbes, parce que ce n’est pas l’esprit de la collection dans laquelle il est publié, mais évidemment ça s’y prête très bien pour donner à voir des fréquences ou des tendances.
Dans le cadre d’une analyse plus fouillée, on peut interroger les corpus à partir des questions que l’on se pose, en leur appliquant une grille d’interprétation composée à partir de variables. Par exemple : tel ou tel article ou programme porte-t-il sur un cas français ou étranger ? L’accent est-il mis sur les causes ou sur les conséquences ? Une imputation de responsabilité est-elle ou non décelable et, si oui, quel type d’acteur est visé : un individu, un groupe informel, une entreprise, etc. ? Le mot « capitalisme » (ou « anthropocène », ou autre) y figure-t-il au moins une fois ? Ce ne sont là que des exemples, parmi de nombreuses possibilités. C’est par exemple ce qu’avait fait il y a déjà dix ans une équipe réunie par Jean-Baptiste Comby et Vincent Romanet concernant le « changement climatique ». En toute rigueur, ce travail reste à faire dans le cas qui nous occupe ; ce sera l’étape d’après !
Pour l’heure, quel bilan tires-tu ? Tu fais état non seulement de la rareté, mais aussi de la récence du traitement médiatique sur le sujet…
C’est en effet ce qui apparaît en première approche. D’une part, la très faible visibilité du thème de la délinquance ou de la criminalité environnementale en tant que tel, c’est-à-dire formulé dans ces termes et pas seulement dans ceux, moins stigmatisants, de l’atteinte, du dommage, etc. Et d’autre part le caractère très récent de son apparition si l’on se donne un minimum de profondeur historique. On repère alors des tentatives sans lendemain, comme celles de Roger Cans, journaliste au Monde, qui en 1991 emploie les expressions « crimes écologiques » et « délit écologique » dans le titre de deux articles distincts (l’un au sujet de la guerre, l’autre à propos de la répression judiciaire des atteintes à l’environnement). Non seulement cet usage ne fait pas tache d’huile, mais ces locutions sont quasiment absentes de la circulation médiatique pendant les années 1990, tous titres de presse confondus.
On peut se dire que ce constat n’est pas en soi une grande surprise : s’il y avait eu un battage médiatique autour de la « délinquance écologique » ou de la « criminalité environnementale », exprimée ainsi, on s’en souviendrait… Et puis, cela reflète un problème plus général dans la médiatisation des questions environnementales, dont Acrimed s’est régulièrement fait l’écho. Ceci dit, ce n’est pas si intuitif que ça et on peut même insister sur l’étonnement que cela pourrait ou devrait susciter. Compte tenu de la montée en puissance des préoccupations environnementales, même trop faible au vu de la gravité des enjeux, on pourrait s’attendre à un recours de plus en plus fréquent à de telles expressions, fût-ce de façon plus ou moins discrète ou modeste. D’autant que, sur le papier au moins, elles ne paraissent pas dénuées de « valeur journalistique ». Or, tout compte fait, c’est très peu le cas.
Bien sûr, cela ne veut pas dire que le thème lui-même est absent du paysage médiatique. Au cours des années 2010, on le voit bien émerger, d’abord sous l’expression « préjudice écologique », puis sous le terme d’« écocide », indéniablement frappant. Mais outre le caractère tardif d’une telle émergence, il est intéressant de noter que, contrairement à des expressions comme « cybercriminalité » ou « délinquance sexuelle », devenues courantes, les atteintes à l’environnement sont rarement qualifiées médiatiquement comme des crimes ou des délits, comme de la criminalité ou de la délinquance, y compris dans des cas où leur légalité est douteuse ou pourrait être questionnée. Des termes qui, a contrario, sont volontiers employés à propos de transgressions qui, en comparaison, peuvent être jugées moins sérieuses, certaines atteintes aux biens ou à la propriété par exemple.
À cet égard, quand des médias parlent des atteintes à l’environnement, tu observes une « réticence journalistique à utiliser une catégorie telle que "criminalité environnementale" ». Quels sont les cadrages qui lui sont préférés ?
On peut schématiquement en distinguer trois, même s’ils ne sont pas exclusifs. Un cadrage général, en termes de dommages, d’atteintes, de nuisances, etc. Un autre en termes d’accident, qui pousse à évacuer toute imputation de responsabilité ou à minimiser le caractère prévisible voire la dimension structurelle d’un événement, qui perd son caractère isolé si on le replace dans une série. Et dans les cas considérés comme les plus graves, un dernier en termes de catastrophe ou de désastre. A priori, ces cadrages ne sont pas incompatibles avec une formulation en termes de délinquance ou de criminalité mais, de fait, ils tendent à l’écarter ou à la recouvrir.
Parler de drame, de dégât ou de tort fait à la nature, ce n’est certes pas rien, mais ça n’a pas la même connotation et ça ne véhicule pas les mêmes représentations qu’une formulation en termes de délinquance ou de criminalité. C’est la même chose pour des termes propres au langage juridique, comme « infraction » et plus encore « contentieux », qui peuvent désigner des faits graves, mais qui charrient un effet de neutralisation. L’idée, banale mais cruciale, c’est que les mots font aussi les choses et qu’en conséquence, désigner une atteinte à l’environnement comme relevant ou non de la « délinquance » ou de la « criminalité », la qualifier ou non comme telle, ce n’est pas anodin. Et ça l’est d’autant moins qu’ensuite, la qualification appelle la quantification (combien de délits et de crimes, dans quels domaines, punis comment, etc.), avec tous les effets de validation suscités par la production de chiffres.
Ce qui soulève aussi le problème de la légalité et de l’illégalité, de ce qui est licite ou non…
Oui, l’un des points importants, c’est de montrer que d’une manière générale les représentations médiatiques pâtissent d’un certain légalisme. C’est-à-dire qu’elles collent aux règles établies ou qu’elles s’y fient sans en questionner l’origine (les rapports de force dont elles dérivent) ou le sens (les principes sur lesquels elles reposent). Les normes juridiques, ça ne vient pas de nulle part et ça n’exprime pas magiquement un improbable « intérêt général »… Bien sûr, la place manque généralement aux journalistes pour se livrer à un tel exercice critique. Mais on ne peut s’empêcher de penser qu’il est tout de même possible de le suggérer en peu de mots, or c’est (très) rarement fait. La qualification médiatique tend alors à conforter la qualification juridique ou judiciaire, et plus largement le discours officiel ou dominant, alors qu’elle pourrait marquer un écart, adopter un point de vue différent.
On peut s’en rendre compte par contraste, grâce à des contre-exemples récents. Je pense tout particulièrement au livre de Mickaël Correia Criminels climatiques, qui porte sur les multinationales du capitalisme fossile. La qualification de « criminel climatique », qui ne figure pas seulement sur la couverture mais se retrouve dans le livre, n’a (encore) rien d’officiel. Elle s’appuie sur une suggestion de Christophe Bonneuil autour de l’idée de « crime climatique », sur la base d’une analogie avec (la qualification de) l’esclavage. Au vu des descriptions qui suivent, le livre, éloquemment construit autour d’une trilogie « Conquérir, exploiter, mentir », n’a aucun mal à justifier la pertinence de cet usage. À moins d’être un ardent défenseur du secteur fossile, on ne se dit pas : non, vraiment, il exagère…
Ce n’est pas un cas isolé. Le récent appel de Politis intitulé « Votre inaction est un crime ! » en est une bonne illustration. Il s’agit bien de proposer une désignation de substitution par rapport à la qualification juridique ou officielle. Mais pour l’instant, ça reste l’exception qui confirme la règle.
Pour expliquer ces phénomènes (rareté, récence et réticence), tu mets l’accent sur une dépendance aux sources officielles. Tu écris notamment que « le traitement journalistique dominant de la question se caractérise […] par sa soumission au calendrier et à la communication des organisations internationales ». Et dans une interview au Média (janvier 2022), tu disais : « Il y a une dépendance à la manière dont les institutions internationales cadrent et formulent le problème. Très généralement, les comptes rendus médiatiques s’appuient sur cette littérature-là, s’en nourrissent mais sans la remettre en question. » Est-ce que tu peux développer ?
Cet aspect rejoint le précédent, dans la mesure où le légalisme que j’évoquais, c’est aussi voire d’abord celui des organisations internationales, en particulier celles émanant de l’Organisation des Nations unies ou gravitant dans son orbite. Ce légalisme-là, visible ou lisible dans les publications produites par ces organisations, n’est bien sûr pas mystérieux. Ce qui pose problème, c’est la façon dont il imprègne la grande majorité des comptes rendus médiatiques. Autrement dit, c’est la tendance médiatique à coller à ce discours autorisé, à en adopter sans distance les partis pris, et du même coup à les diffuser et les légitimer. Ce qui produit une double couche de fausse neutralité, d’autant plus difficile à mettre en cause qu’elle fait part d’actes ou de phénomènes objectivement choquants ou propres à susciter l’indignation (le braconnage d’espèces protégées, par exemple).
Car un discours coproduit par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et Interpol, comme c’est le cas pour la « criminalité environnementale » au cours des années 2010, ça n’a rien de neutre, quand bien même ça se présente sous une forme documentée et soignée. Ce n’est pas qu’il faille s’en débarrasser sous prétexte que ça ne vaudrait rien ; c’est même parfois précieux. Simplement qu’il faut tenir compte des conditions de production de ce genre de documents pour en apprécier le contenu. Un contenu qui, par exemple, passe sous silence l’échange économique et écologique inégal, dans le cadre des rapports de domination géopolitiques. Ou bien qui, en braquant l’attention sur le « crime organisé » tel que légalement défini, escamote le rôle des grandes entreprises dans la destruction du vivant… mais aussi dans la définition des normes légales, par voie de lobbying. Et qui par conséquent ne livre qu’une représentation partielle, voire biaisée du phénomène considéré. De ce point de vue, sa validation médiatique pose problème.
Et elle pose d’autant plus problème qu’elle a des effets sur le champ politique. Cet aspect est laissé de côté dans le livre, mais j’avais aussi travaillé à partir de la « collection des discours publics », une base de données libre d’accès en ligne. Le site a changé depuis, compliquant l’actualisation des données, mais jusqu’en 2017 l’enjeu des crimes et délits contre l’environnement était en deçà de la marginalité politique. On était plutôt dans la quasi-inexistence ! Là aussi, on voit des tentatives qui échouent, en particulier de la part de l’ancien journaliste et alors responsable politique Noël Mamère, qui s’efforce en vain d’introduire cette question à l’occasion de la campagne présidentielle de 2002, dans la foulée notamment du deuxième Forum social mondial de Porto Alegre. On ne trouve ensuite que de très rares mentions isolées. Ce qui, en retour, n’est pas sans effet sur la prise en charge médiatique…
Le travail d’enquête et de reportage est donc indispensable pour sortir d’un tel traitement médiatique. Un travail qui est notamment assuré par les médias indépendants (malgré des moyens limités)…
En effet ! C’est d’ailleurs un travail bien plus difficile et exigeant que celui que j’ai réalisé là, ce dont j’ai bien conscience. Sur un tel sujet, la difficulté pratique, c’est bien souvent de savoir fouiner, insister quand on se heurte à des refus, accéder aux coulisses, recueillir une parole qui soit autre chose que du pur discours officiel, etc., le tout en devant composer avec de fortes contraintes professionnelles. Je ne pouvais pas mentionner à chaque fois tel ou tel effort en ce sens, et j’ai taillé dans les références « médiatiques » pour éviter d’allonger les notes outre mesure, mais je cite quelques supports de sorte à « envoyer un signal », pour ainsi dire. Car évidemment je suis nourri par ces efforts, qui ont contribué à m’ouvrir les yeux, parallèlement à des lectures plus théoriques. Sur la question environnementale en général comme sur les atteintes à l’environnement en particulier, le travail fait par des journalistes dans divers médias (du côté notamment de Basta !, CQFD, Mediapart, Politis, Reporterre, etc.) est précieux et même indispensable. De courts articles journalistiques précis et percutants, y compris dans la presse mainstream, en disent parfois autant sinon davantage que de longs et bavards articles universitaires, dans la sphère anglophone notamment.
… et aussi, parfois, par des médias dominants, mais tu expliques – en étudiant le cas du Monde – que ces enquêtes sont reléguées et ne font pas la Une.
Tu fais sans doute référence à un article de Rémi Barroux de juin 2014 qui, je le précise, a contribué à m’orienter vers cette question. Cette notion de « criminalité environnementale » m’avait interpellé à l’époque, de même que la coopération entre Interpol et le PNUE qui est à l’origine de l’article, et je me suis dit qu’il y avait matière à creuser… C’est un exemple auquel il est difficile de résister, car il exprime de manière flagrante le décalage entre la gravité du sujet traité (l’article fait quand même froid dans le dos) et la façon dont il est finalement présenté, au terme je suppose d’un débat interne à la rédaction, avec une accroche de première page au même rang et au même format que des événements parfaitement anecdotiques.
Plus largement, l’exemple du Monde me fournit un argument a fortiori. Comme suggéré tout à l’heure, c’est sans doute le journal qui, au sein de la presse écrite généraliste, s’est le plus efforcé de thématiser comme telle la délinquance ou la criminalité environnementale, aussi bien quantitativement que qualitativement. Ce qui en dit long sur le manque d’ampleur de la couverture médiatique en général sur le sujet. D’autant que les limites ou les travers déjà évoqués s’y retrouvent, y compris le manque de recul par rapport à la documentation plus ou moins officielle, onusienne en particulier. Mais on peut dire la même chose, plus généralement, sur les « statistiques de la délinquance », par exemple, une question sur laquelle existent bon nombre de mises au point sociologiques dont on peine à retrouver l’empreinte dans le gros du traitement médiatique sur le sujet.
Peut-on dire que dans le sens commun journalistique la « criminalité environnementale » est un concept qui, aujourd’hui, existe au mieux dans sa conception minimaliste (les atteintes à l’environnement illégales) ? Et, de ce fait, peut-on dire de cette conception qu’elle participe (à sa mesure) à la reproduction de l’ordre social et économique tel qu’il est ?
Je suis bien tenté de le dire, en effet ! C’est d’ailleurs en ce sens que, dans l’introduction du bouquin, référence est faite au concept de « pouvoir symbolique » chez Pierre Bourdieu. Lequel pouvoir, celui de nommer le réel dans des termes reconnus socialement, n’a rien de superficiel ou d’inconsistant, bien au contraire. C’est là au fond le problème qui sous-tend le livre : quels sont les effets de pouvoir inhérents à la délimitation, la désignation, la dénomination d’un ensemble de pratiques comme relevant ou non de la « délinquance » ou de la « criminalité » dite « environnementale » ? Tous ces termes posent problème d’une façon ou d’une autre, y compris celui d’environnement, qui suppose une coupure entre les êtres humains et le reste du vivant.
Même sans entrer dans ce débat, on peut prendre un exemple concret pour donner un aperçu de ce dont il retourne, celui de la déforestation. La déforestation illégale est volontiers stigmatisée. Très bien ; personne ne songe à la défendre, mis à part ceux qui en tirent profit – pas seulement de purs « réseaux criminels », loin de là ! Le problème, c’est que l’opération de démarcation dont procède la notion de déforestation illégale a pour effet, par contrecoup, de légitimer ou d’innocenter la déforestation légale, comme si celle-ci ne posait guère problème. Or rien n’est moins sûr, c’est le moins que l’on puisse dire. Il faut donc s’interroger sur la ligne de partage établie entre légalité et illégalité, dans ce domaine comme dans d’autres.
C’est la raison pour laquelle l’objet d’étude, d’un point de vue sociologique, ce n’est pas la description de quelque chose qui serait tout prêt, bien balisé et qui serait la délinquance ou la criminalité environnementale, mais plutôt le travail de qualification et de quantification qui fait exister socialement quelque chose qui est connu et reconnu comme tel — comme c’est le cas pour la « folie », la « richesse » ou le « travail ». Ça peut sembler ergoter, mais en fait c’est essentiel !
Propos recueillis par Maxime Friot