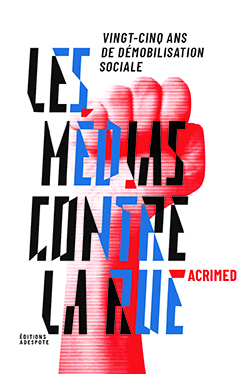Depuis 25 ans, l’association Acrimed (Action-Critique-Médias), créée en 1996 dans la foulée et en réaction au traitement médiatique des mobilisations contre le plan Juppé en novembre 1995, a beaucoup diversifié les cibles de ses observations. Mais elle n’a jamais cessé de scruter la façon dont les médias dominants s’adonnent régulièrement à l’un de leurs sports favoris : la démobilisation sociale.
Et depuis 25 ans, les occasions n’ont pas manqué. Après avoir soutenu le plan Juppé, la quasi-totalité des grands médias ont salué (entre autres) : en 2003, « la réforme » du statut des intermittents et des retraites ; en 2006, le « Contrat première embauche » ; en 2007, « la réforme » des régimes spéciaux de retraites ; en 2009, celle des universités ; en 2010, celle des retraites (encore) ; en 2014 (déjà), celle de la SNCF ; en 2016, la loi Travail ; en 2018, « la réforme » de la SNCF (à nouveau) ; en 2020, celle des retraites (toujours), etc., etc. Liste non exhaustive, et en constante augmentation.
Depuis 25 ans, chaque réforme néolibérale, chaque régression sociale, entraîne immanquablement une nouvelle mobilisation médiatique. Mais comme dans une série à bas prix confiée à des scénaristes paresseux, chaque nouvel épisode frappe par sa ressemblance avec le précédent. Mis à part quelques détails négligeables (en particulier le fond de la réforme et les revendications des grévistes), généralement laissés hors-champ, rien ne ressemble plus à un mouvement social, vu à travers le prisme déformant et méprisant des partis pris et des caricatures médiatiques, qu’un autre mouvement social : inutile, importun, inopportun, essoufflé avant d’avoir commencé, menacé à tout instant de sombrer dans la violence sinon le chaos. Le scénario est bien balisé, le vocabulaire bien rodé, les formats bien ajustés : « la réforme » a une étonnante capacité à mettre en marche la machine médiatique à fabriquer sa bouillie, parfaitement conforme aux intentions des « élites » économico-politiques.

La critique – précise, rigoureuse, s’appuyant sur la sociologie et l’économie pour affûter sa radicalité – des mauvais traitements médiatiques infligés aux mouvements sociaux, à leurs acteurs et aux revendications qu’ils portent, est donc cruciale. Suscitant (pour les plus importants, qui mobilisent de larges secteurs du monde du travail) beaucoup de bruit médiatique – et pour d’autres des silences éloquents –, dévoilant un unanimisme confondant, révélant, sous la morgue et le mépris décomplexés, la violence des rapports sociaux, ces épisodes sont riches d’enseignements sur la contribution du petit monde des grands médias au maintien de l’ordre social – nous rappelant ainsi régulièrement qu’on ne saurait parvenir à changer le second sans se préoccuper sérieusement du premier.
Qu’il s’agisse des médias privés, aux mains de milliardaires à la tête de grandes entreprises qui sont des acteurs économiques majeurs, ou des médias publics, dont les dirigeants épousent le point de vue des gouvernants qui les nomment ou les surveillent, les médias « dominants » jouent leur partition dans la grande symphonie de la domination sociale. Loin d’être de simples « médiums », intermédiaires ou témoins, ils sont ainsi partie prenante des conflits sociaux sur lesquels ils prétendent informer.
À chaque mouvement social de quelque ampleur, l’orchestre médiatique se met ainsi en ordre de bataille, chacun à sa place et remplissant sa fonction, de l’éditorialiste chargé d’expliquer doctement à quel point les manifestants ont tort de s’opposer à « la réforme » à l’« expert » chargé d’expliquer doctement à quel point le gouvernement a raison de la mettre en place, en passant par le présentateur-intervieweur chargé de leur confier la parole et de la confisquer à tous les autres.
L’orchestre médiatique a ceci de particulier qu’il n’a pas besoin d’un chef pour trouver sa direction, qui est peu ou prou toujours la même : dans le sens du vent et du côté du manche. Pour cela il suffit d’avoir soigneusement promu les cadres, « chefs de service » et autres sommités de l’information, en fonction de leur incurie, leur incompétence et leur servilité. Cette « éditocratie » ne se confond pas avec les quelques enquêteurs dont elle recouvre l’activité, et encore moins avec les « soutiers de l’information », majeure partie de la profession, souvent précarisée et soumise à une hiérarchie qui veille au grain, formatée plus que formée par les écoles de journalisme, qui produit certes des « contenus » désastreux, mais sur commande, parfois à contrecœur et souvent par nécessité.
Mais si, au sein du journalisme, tous les acteurs n’ont pas la même implication ni les mêmes responsabilités, il n’en demeure pas moins que pris dans leur ensemble et selon leur plus grande pente, les grands médias se situent clairement du côté du pouvoir et de la classe dirigeante. Et il ne suffit pas de le dire : il importe de le montrer, en détail, pour bien mesurer, comprendre et le cas échéant dénoncer à bon escient, sans le surestimer, le rôle qu’ils jouent. Pour notre part, nos vingt-cinq ans d’observations nous permettent de poser un diagnostic relativement précis sur la façon dont les médias dominants (re)couvrent et (mal)traitent un mouvement social. Certes il y a des nuances, des ajustements, des variations, d’un média à l’autre, d’une mobilisation à l’autre.
Mais il y a aussi des invariants, massifs, et des tendances, lourdes.
Comment (re)couvrir un mouvement social
Ce qui est le plus évident, pour un observateur tant soit peu critique, c’est sans doute l’hostilité – à peu près unanime, même si son intensité peut varier – des commentateurs officiels. Mais ce n’est pourtant pas la seule façon, ni peut-être la pire, de nuire à un mouvement social : les routines professionnelles du journalisme « mainstream » s’en chargent tout aussi bien, et plus discrètement.
Vu à travers le prisme médiatique, passé à la moulinette des filtres, des cadres et des formats des principaux médias, un mouvement social est d’abord une « info » parmi d’autres, un « sujet ». Ce sujet sera traité (avec les aménagements spécifiques qu’il mérite) comme tel : comme un « événement » destiné à entrer (de gré ou de force) dans un scénario dont les grandes lignes sont écrites à l’avance. Et bien souvent, la première étape de ce processus consiste précisément à faire de cet événement… un non-événement.
Ignorer, minorer
Car la conséquence logique du désintérêt médiatique pour l’enquête sociale et de la réduction de la politique aux querelles et aux intrigues du petit cercle des « têtes d’affiche » des grands partis, c’est que les médias sont bien souvent à la traîne dans la couverture des mouvements sociaux – avec des variations là encore, en fonction de l’ampleur des mouvements, de la catégorie des travailleurs concernés, de leur plus ou moins grande distance avec les sommités du journalisme. Dans le meilleur des cas, c’est à la veille de la première manifestation que les journaux annonceront cette dernière, annonce qui sera l’occasion, à côté du détail des conséquences (fâcheuses) à prévoir, d’informer de l’existence d’une opposition à un projet de réforme (on ira rarement plus loin dans l’information, au moins dans un premier temps). Une mobilisation sectorielle, limitée à une profession engagée dans une lutte spécifique, ne parviendra parfois jamais à l’existence médiatique. À moins que Leurs Éminences finissent par être incommodées jusque dans leurs beaux quartiers par les mauvaises odeurs, peu de chance que les chefferies éditoriales daignent accorder la moindre attention à une grève des éboueurs…
Si le mouvement a trop d’ampleur pour être purement et simplement ignoré, il sera diversement mais invariablement minoré : non pas – ou pas seulement – quantitativement, en jouant sur les chiffres (en privilégiant ceux fournis par le pouvoir en place, en comparant des mobilisations qui n’ont pas grand-chose à voir… – en la matière, l’imagination des médias dominants est assez féconde), mais d’abord qualitativement, en le réduisant aux manifestations qui le ponctuent.
Ausculter, diagnostiquer, pronostiquer
Cette réduction n’a pourtant rien d’évident. Tous ceux qui ont participé à un mouvement social le savent : on ne saurait en rendre compte en se contentant d’égrener les chiffres des manifestations successives. Or la plupart des médias limitent généralement leur couverture à ces épisodes – pour ne rien dire encore de la façon dont ils les couvrent. Assemblées générales, débats, contre-propositions, actions (quand elles ne sont pas spectaculaires et/ou destinées, précisément, à attirer leur attention) : tout cela passe généralement sous le radar des commentateurs officiels, qui s’attardent sur les chiffres mesurant les cortèges et, sur cette base, auscultent la vigueur de la contestation, diagnostiquant « l’état du rapport de forces » ou pronostiquant l’issue de la mobilisation – ces métaphores médicales n’ayant rien de gratuit, les éditocrates considérant régulièrement les mobilisés comme de doux (mais parfois enragés) malades, en proie à des affects qui leur troublent l’esprit et dont ils craignent la « contagion ».
Siffler la fin de la récré (avant qu’elle ait commencé)
Appelés au chevet d’une mobilisation quelconque, ces médecins imaginaires ont ceci de particulier qu’ils se délectent de guetter et d’annoncer sa mort, quand ils ne l’appellent pas ouvertement de leurs vœux. Inquiets pour un corps social miné par une maladie aux symptômes divers et aux noms variés, mais qu’ils appellent généralement « refus de la réforme », « archaïsme » ou « corporatisme », ils observent les journées de mobilisation comme autant de convulsions, dont on commente la fréquence et l’intensité – mais dont le terme ne saurait être que la purge de ces mauvaises passions. Ces prophéties, heureusement pas toujours auto-réalisatrices, mais qui n’en sont pas moins révélatrices de l’espérance qui les motive, apparaissent parfois très tôt dans la couverture d’un mouvement social, dont on s’efforce de décrire l’essoufflement, parfois même avant qu’il ait débuté. Et si le mouvement perdure, s’il fait de la résistance ou, pire, s’il s’amplifie, on sifflera alors la fin de la récréation, devant les images de violences (commises par les manifestants) qu’on passera en boucle, en criant à la chienlit et en appelant l’exécutif à la rescousse pour mettre un point final à cette dangereuse récidive.
Raconter les effets, oublier les causes
Autre routine médiatique, tellement systématique qu’elle tend à devenir la norme dans nombre de reportages : (re)couvrir les journées de mobilisation et de manifestation en se focalisant sur les désagréments qu’elles vont occasionner.
Embouteillages prévus, trains qui ne partiront pas, quartiers à éviter – et « galères » diverses glanées sur le terrain par des envoyés spéciaux compatissants – envahissent les ondes et les écrans. Le détail des conséquences néfastes des grèves, sujet inépuisable, « facile » et dépolitisé, se substitue avantageusement à l’exposé de leurs causes – ou de « remèdes » autres que « la réforme » elle-même. Routine qui permet par ailleurs, et ce n’est pas là son moindre intérêt, de diviser la population en deux : « grévistes » contre « victimes des grévistes ».
Rien ne plaît d’ailleurs tant à certains experts en distinctions que de dresser la liste des « non-concernés » par tel ou tel mouvement. Ainsi les lycéens seront sommés de ne pas s’opposer à une réforme des retraites qui ne les « concernerait » en rien, et les fonctionnaires ou toute autre partie de la population active seront priés d’applaudir celle des « régimes spéciaux » qui ne « concernent » que d’affreux privilégiés avec lesquels toute solidarité est manifestement inenvisageable. Le profil socio-économique de nos maîtres à penser les mettant largement à l’abri des effets néfastes des réformes qu’ils soutiennent, ils pourraient à ce compte figurer eux-mêmes parmi ces « pas concernés » – mais généralement personne n’est là pour le leur faire remarquer.
Ainsi, entre les routines journalistiques qui tendent à le dénaturer et les commentaires qui s’efforcent de le délégitimer, un mouvement social a toutes les chances de ressortir en miettes de la moulinette médiatique. Ceux qui le soutiennent ou y participent ne devraient jamais perdre cela de vue, en particulier quand il s’agit d’y faire entendre leur voix. D’autant que d’autres obstacles les attendent.

Paroles, paroles
L’univers médiatique est en effet avant tout un univers de discours, dont le lexique, les règles et les dispositifs sont autant de pièges tendus aux contestataires.
« Laréforme »
C’est d’abord le lexique journalistique auquel on sera confronté, un lexique hérissé de fausses évidences, de mots en trompe l’œil, de métaphores sournoises, composant une petite musique dépréciative qui fait passer, en contrebande (mais plus ou moins discrètement), un message. Comme nous l’écrivions dans notre presque célèbre « Lexique pour temps de grève et de manifestation » (page 34), la langue automatique du journalisme officiel est une langue de bois officielle. L’exemple emblématique en est sans doute « la réforme », qu’on serait tenté d’écrire en un seul mot, tant le singulier et l’article défini sont de rigueur pour désigner tout projet d’inspiration néolibérale, et particulièrement ceux qui dégradent la protection sociale de tout ou partie de la population. Dans la plupart des grands médias, on ne s’oppose pas à « une réforme », on ne conteste pas le bien-fondé ou l’idéologie de « certaines réformes », on ne discute pas du contenu précis de « cette réforme », on n’imagine pas « d’autres réformes » : on est pour ou contre « laréforme ».
Et généralement, on est pour. Ceux qui s’y opposent seront logiquement taxés d’archaïsme, de frilosité ou, par un retournement que n’aurait pas renié Orwell, de conservatisme.
Autre cliché médiatique qui pourrait passer inaperçu tant il est répandu : la « grogne », aimable métaphore animale qui renvoie ainsi une mobilisation quelconque à un bruit inarticulé, expression d’une humeur chagrine et d’un refus qui confine au mouvement réflexe. Ce terme, qui vaut à lui seul un petit éditorial, n’en est pas moins employé en toute occasion. Il suffit pourtant, pour mesurer sa charge symbolique, de se demander si l’on parlerait aussi aisément, par exemple, de « la grogne du président de la République ».
Discours de « la méthode »
« Méthode » : le terme, absent de notre Lexique, aurait mérité d’y figurer. Non que le mot soit en lui-même problématique ou chargé de connotations négatives, mais, dans le contexte des luttes sociales, il sert surtout à esquiver les enjeux de fond. La « méthode », celle qui est ou devrait être utilisée pour faire réussir « laréforme », c’est en effet le sujet dont on peut et doit parler – par opposition au contenu précis de telle ou telle réforme, de ses tenants et de ses aboutissants. Et les experts en bavardage ne s’en privent d’ailleurs pas, commentant à loisir la méthode choisie, par exemple pour saluer la voie de la « consultation » suivie par le gouvernement, ou, en cas de « crise » ou de « blocage », pour le conseiller sur la meilleure façon de sortir de « l’impasse » – en sauvant, cela va de soi, « laréforme ». Du reste, cette méthode se résume généralement en un mot : la « pédagogie », puisque « laréforme » est bonne par principe, et que ses opposants ne peuvent la rejeter que par ignorance ou incompréhension. La focalisation sur la « méthode » illustre ainsi ce pouvoir de cadrage, qui n’est pas le moindre de ceux dont disposent les médias dominants, délimitant les problèmes légitimes, ceux dont on peut parler, la façon dont on peut en discuter et l’angle sous lequel les aborder. Elle met également en évidence le rôle dont les éditorialistes et les commentateurs officiels se sentent investis : chuchoteurs à l’oreille des princes ou conseillers en communication – loin, bien loin du mythe d’un « quatrième pouvoir » qui s’attacherait à contrôler les trois premiers.
Donner la parole ?
Pour ceux qui contestent « laréforme », et plus généralement un ordre social dont les médias dominants sont l’un des piliers et dont les tenanciers occupent les meilleures places, l’espace médiatique s’apparente donc à une arène peuplée d’adversaires et fourmillant de pièges. Prendre la parole pour tenir un discours différent de celui qui, à quelques nuances près, y est déversé tous les jours est, pour celles et ceux qui ne sont pas préalablement accrédités, une véritable gageure.
D’ailleurs, on n’y prend pas la parole : ce sont les chefferies de ces médias qui vous la donnent, ou plutôt vous la concèdent, avec modération et parcimonie.
Sans même évoquer un décompte purement quantitatif qui leur serait naturellement très défavorable, la discrimination qui frappe les contestataires est encore aggravée par l’inégalité qualitative d’accès à la parole publique. En effet, à part quelques figures du mouvement social, dirigeants syndicaux ou responsables politiques plus ou moins rompus aux divers exercices médiatiques (mais qui s’y font tout autant régulièrement étrillés), les « vrais gens » – comme les appellent parfois, avec une profondeur involontaire, les grands pontes des médias qui n’en fréquentent guère – se trouvent sur un plateau comme un chien dans un jeu de quilles. N’en possédant pas les codes, les règles, les manières, ces intrus sont sommés de répondre à des questions qu’ils ne se posent pas dans un temps qui ne le leur permet pas, confrontés à des « experts » au verbe facile et à un environnement structurellement hostile aux mobilisations et aux revendications qu’ils viennent défendre.
Comme l’indiquait Pierre Bourdieu (Sur la télévision, Raisons d’agir, 1996, p. 32-37), à côté des débats « vraiment faux », qui réunissent des « compères » d’accord sur l’essentiel et souvent aussi sur l’accessoire, il y a en effet ces débats « faussement vrais », dont l’apparente diversité n’en est pas moins minée par des mécanismes de domination sociale qui les traversent. Si les journalistes qui distribuent la parole voulaient vraiment la recueillir et la donner à entendre, il faudrait qu’ils se comportent d’une tout autre manière, et imaginent des dispositifs qui faciliteraient la participation réelle de ceux qui sont dépourvus des compétences que confère une pratique régulière de l’univers médiatique et de la prise de parole. Pour tenter de compenser ce désavantage, il faudrait tordre le bâton dans l’autre sens : faire preuve de plus de bienveillance, d’écoute, de patience, et laisser plus de temps. Traité à égalité avec un habitué des micros, un homme – et plus encore une femme – « du commun » serait encore discriminé. Mais il n’est même pas question d’égalité : dans la « vraie vie », les « vrais gens », surtout s’ils s’opposent à la vulgate médiatique, seront impitoyablement soumis à la question, interrompus, maltraités.
Tolérés uniquement dans la mesure où leur présence permet de conserver les apparences du « débat démocratique » dont les médias se veulent l’espace privilégié, ils y sont en réalité réduits au silence tant leur parole est encadrée, tronquée, distordue et finalement marginalisée et disqualifiée.
Et comme pour achever de vider le débat public de toute scorie critique et démultiplier ainsi leur puissance démobilisatrice, les dispositifs médiatiques s’appliquent systématiquement et mimétiquement à neutraliser, voire à noyer ou ensevelir toute voix hostile à « laréforme » sous un déluge d’ersatz d’informations aussi inutiles que dérisoires et prévisibles, mais qui ont le double avantage de meubler l’antenne ou remplir les colonnes et… de faire diversion !
Formats, formatage et déformation
Car l’espace médiatique dominant n’est pas en accès libre.
Pour y exister, il faut se couler sinon dans un moule, du moins dans une forme : un « format ». Le hasard faisant bien les choses, un certain nombre de ces formats médiatiques sont parfaitement ajustés à l’entreprise de défiguration, sinon de sabotage, des mobilisations sociales.
Micros-trottoirs
Premier de ces formats déformants : le micro-trottoir, et en particulier celui qui passe en revue les motifs de mécontentement des usagers un jour de grève. Micro-trottoir qui, comme son nom l’indique, consiste à promener micro et caméra dans la rue pour y interroger – en théorie ! – tout un chacun, cherche à donner le sentiment d’une saisie sans médiation de « l’opinion ». Cette saisie illusoire n’est souvent qu’une grossière escroquerie : les réactions, n’excédant pas une poignée de secondes, sont soigneusement sélectionnées, quand elles ne sont pas préparées à l’avance, en envoyant un journaliste, de préférence soutier ou stagiaire, arpenter les quais du métro en panne pour recueillir les témoignages désapprobateurs des usagers. Du reste, même si un micro-trottoir n’était pas uniquement constitué de ce genre de réactions, il n’en serait pas moins contestable en tant que tel : pour sa valeur informative nulle et sa partialité cachée et impossible à évaluer. Quant aux réactions des usagers mécontents de l’état des transports publics en dehors des périodes d’agitation sociale, elles ne semblent pas retenir beaucoup l’attention des rédactions.
Micro-sujets
Ces micros-trottoirs prennent généralement place dans des « sujets » dont il faut souligner par ailleurs la brièveté, et par conséquent l’indigence. En deux minutes, durée moyenne d’un sujet de JT, que peut-on dire, quel contenu informatif peut-on espérer transmettre au téléspectateur ? Pourtant, les JT savent parfois s’affranchir des contraintes que leur imposent leurs propres routines – mais il faut pour cela tenir un véritable « événement » : une victoire sportive, un mariage princier, une chute de neige d’une ampleur imprévue. Dans ces cas-là, les rédactions n’hésitent pas à sortir l’artillerie lourde, à diversifier les angles, à multiplier les reportages, à envoyer des journalistes sur place pour des directs et des duplex. Que ce déploiement de moyens ne donne qu’un résultat proche du néant du point de vue de l’information ne change rien à l’affaire, et montre par contraste le peu d’intérêt – ou peut-être la crainte – que suscitent les mobilisations sociales tant qu’elles ne sont pas massives et de préférence émaillées de violences. Ce n’est pas le moindre des pouvoirs dont disposent les médias audiovisuels que celui d’occulter les sujets qui les ennuient ou qui feraient fuir, pensent-ils, les téléspectateurs – et ils ne s’en privent pas.
Portraits
Autre format dont les grands médias sont friands et qui montre là encore leur fâcheuse propension à faire diversion : le portrait.
Non que ce genre, qui n’est pas propre à l’univers journalistique, soit vicié par nature : c’est bien son utilisation, notamment dans le contexte d’une mobilisation sociale de quelque ampleur, qui est problématique. Indépendamment même du « point de vue » adopté – on ne s’étonnera guère de voir fleurir les portraits à charge de dirigeants syndicaux ou de responsables politiques non alignés, en passe de devenir un sous-genre médiatique à part entière –, c’est la logique même de ces portraits, produits par des médias toujours en quête de « personnalités », de bons clients, de « porte-parole », à condition de pouvoir les sélectionner eux-mêmes, qui est ici en cause. Faisant la promotion d’individus, s’intéressant à leur trajectoire dans ce qu’elle a de plus singulier, et, spécifiquement, d’anecdotique ou de folklorique, l’art du portrait ainsi manié est une arme de dépolitisation massive, doublé d’une machine à dissoudre le collectif.
Débats
Au nombre de ces formats prisés par les chefferies éditoriales par temps de crise sociale, on ne saurait oublier les « débats » audiovisuels. À ce sujet, la typologie minimale, précédemment citée, de Pierre Bourdieu distinguant les débats « vraiment faux » des débats « faussement vrais » dit presque tout. D’autant qu’on chercherait en vain, notamment sur les chaînes d’information en continu, un débat d’un « troisième type » ! Notons que les interviews de responsables politiques ou syndicaux obéissent à la même logique et à la même répartition : on assistera ainsi à des causeries amènes entre gens de bonne compagnie si les positions de l’invité sont conformes à la doxa du média qui l’accueille, qui se transformeront en interrogatoires serrés et parfois violents si le suspect s’avise de défendre des idées hétérodoxes, professant par exemple ses doutes au sujet du bien-fondé de « laréforme », la croissance ou la dérégulation…
Autant de biais de perception, d’expression, de présentation qui nuisent gravement à l’information sur les mobilisations, les analyses et les contre-propositions des manifestants. S’il y a un « pouvoir des médias », il s’agit avant tout d’un pouvoir de délégitimation et d’occultation (qui dissimule en montrant), qui n’est pas tout puissant et dont les effets sur les lecteurs, les auditeurs et les téléspectateurs sont difficiles à mesurer. Mais il serait naïf de croire qu’il est inoffensif.
Pour apprécier pleinement ce rôle, il faudrait d’ailleurs resituer la couverture des mouvements sociaux dans l’ensemble de la production médiatique, qui ne se caractérise guère, si l’on excepte quelques fleurons de la presse écrite et de rares émissions, par l’intérêt porté au « monde des idées » (la recherche universitaire, et en particulier l’économie et la sociologie critiques), par l’attention à la vie syndicale, au « monde du travail » ou le souci d’en rendre compte. Autant d’univers devenus parfaitement étrangers au journalisme de fréquentation du patronat et de la noblesse d’État qui peuple les cabinets ministériels. Les moments de tempête sociale, qui pourraient – rêvons un peu ! – permettre de « rattraper le temps perdu » et de rééquilibrer la représentation effective des classes populaires, sont au contraire, et au fond très logiquement, autant d’occasions d’enfoncer les clous plantés jour après jour par ceux qui chantent sur tous les tons les bienfaits de « laréforme ».
À quelques exceptions près, les mauvais traitements par temps de mobilisation sociale ne se détachent pas sur un fond neutre ou équitable par temps moins agité ; ils s’inscrivent dans des processus beaucoup plus larges et profonds, qui jour après jour invisibilisent la réalité sociale, instillent le mépris de classe et prodiguent des leçons de savoir-se-taire. En d’autres termes, pour tendre à une représentation socialement plus équilibrée, il faudrait commencer, lors d’une mobilisation sociale, par couper tous les micros de ceux qui les confisquent quotidiennement pour les confier à tous ceux qui n’y ont jamais ou si chichement la parole. Et l’on serait encore loin du compte.