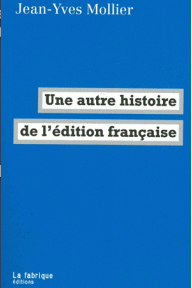Pourquoi une « autre » histoire ?
Parce qu’il y en a déjà une, et parce que celle-ci est différente ; mais ce n’est pas une « contre-histoire » de l’édition, une histoire alternative, comme l’est, par exemple, l’Histoire populaire des Etats-Unis de Howard Zinn par rapport à l’histoire officielle.
La première grande histoire de l’édition française est celle qui fut coordonnée par Roger Chartier et Henri-Jean Martin de 1983 à 1986. Avec ses 3 000 pages, cette histoire en quatre volumes a été rédigée par un grand nombre de contributeurs. Rien de tel ici. Jean-Yves Mollier est l’auteur unique de cette histoire beaucoup plus condensée (450 pages) et bénéficiant de nouvelles sources, comme les archives du Syndicat national de l’édition, ouvertes pour la première fois à son intention en 2006. Nous avons affaire ici à un point de vue de chercheur étayé sur des connaissances, plutôt qu’à une somme de ces connaissances, comme a pu l’être le premier ouvrage de Chartier et Martin, même s’il ne fut pas que cela, à une époque où l’histoire du livre et de l’édition était une discipline assez neuve.
C’est aussi une « autre » histoire de l’édition parce que Jean-Yves Mollier insère cette histoire dans l’évolution de la société dans son ensemble, son économie, sa culture, ses révolutions, ses guerres, etc., évolution dans laquelle les rapports avec les pouvoirs en place prennent une importance décisive pour les éditeurs. Ajoutons enfin que, sans avoir vocation à devenir un best-seller, ce livre, par son prix et son contenu, s’adresse à un public sensiblement plus large que le précédent.
Il est divisé en 13 chapitres d’une trentaine de pages chacun, ordonnés chronologiquement, mais aussi selon des thèmes [1], d’une introduction qui en résume le propos et d’une brève conclusion sur l’avenir de l’édition. Des index des noms, institutions, collections et périodiques cités en font un véritable outil de travail pour les chercheurs. Dans l’impossibilité de restituer la richesse de cet ouvrage à la lecture duquel nous ne pouvons qu’inviter, nous nous limiterons à en retenir les grands traits tout en soulignant quelques éléments intéressant la critique des médias.
Préhistoire de l’édition
Jean-Yves Mollier situe la naissance de l’édition à la fin du XVIIIe siècle, et ce que nous appellerons sa préhistoire à l’invention de l’imprimerie. De cette dernière, il retient, non seulement l’aspect technique de multiplicateur des écrits, mais surtout l’effet profond qu’aura ce progrès technique sur la propagation des idées nouvelles au moment de la Réforme et de la Contre-Réforme encourageant notamment, pour des raisons d’efficacité de la propagande, des éditions en langue locale au lieu du latin. On notera, par analogie avec les débats contemporains autour du livre électronique, que les premiers livres imprimés s’efforçaient d’imiter au plus près les manuscrits, ce qui n’est pas sans rappeler les efforts tragi-comiques des fabricants de liseuses électroniques pour imiter le livre papier, jusqu’au tournage des pages simulé sur l’appareil.
Sous l’Ancien Régime, la fonction éditoriale est assurée par les imprimeurs-libraires. Cette activité fait peur aux pouvoirs en place, religieux et politiques : « La censure fut la marque constitutive de la librairie française d’Ancien Régime », nous dit l’auteur. Les « éditeurs » avant la lettre devaient obtenir un « privilège » royal, autorisation d’imprimer accordée par le pouvoir royal, et se soumettre à la censure exercée sur chaque publication. Ce contrôle de l’écrit et de l’imprimé, qui perdurera jusqu’en 1881, aura pour effet secondaire une contribution significative à la concentration de l’activité éditoriale en région parisienne, avec la décision de Louis XIV de « transférer à Versailles les instances chargées d’attribuer les privilèges, de lire les manuscrits et d’accorder l’autorisation », concentration qui se maintiendra jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, et même, jusqu’à un certain point, jusqu’à nos jours. Cette censure était contournée par des publications sous fausse adresse ou dans des pays voisins. Elle n’a pas empêché la prolifération des libelles et des pamphlets, premières publications politiques, tandis que se développaient par ailleurs les « canards » et « placards » dans lesquels « les phénomènes cosmiques, planètes ou étoiles monstrueuses, les diableries, les miracles, les inondations et tremblements de terre annoncent, à n’en pas douter, les préférences de maintes chaînes de télévision actuelles ». Les auteurs ne sont pas plus libres que les éditeurs et souvent sous la « protection » de mécènes. Voltaire et Diderot firent de la prison et à la veille de la Révolution, 17% des embastillés étaient des hommes de lettres.
À la fin de l’Ancien Régime, le grand succès de la publication de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (24 000 exemplaires), l’apparition du premier éditeur en la personne de Joseph Panckoucke, véritable « magnat de la presse et de l’édition » avant l’heure, détenteur d’une quinzaine de revues et d’une véritable « écurie d’auteurs », le règlement de 1777 reconnaissant le droit d’auteur, tous ces phénomènes associés à une soif de connaissances nouvelle en Europe, sont autant d’indices qui annoncent, nous dit Jean-Yves Mollier, la naissance de l’éditeur moderne.
Histoire de l’édition (proprement dite)
La loi du 19 juillet 1793 définit le droit d’auteur plus précisément que le règlement de 1777. L’auteur devient le titulaire exclusif des droits sur son œuvre (et ses descendants jusqu’à 10 ans après sa mort – 70 ans aujourd’hui !), droits qu’il peut céder en tout ou partie. À ce fondement juridique de l’activité de l’éditeur en tant que cessionnaire des droits de l’auteur, Jean-Yves Mollier ajoute un fondement socio-économique : « l’autonomisation progressive des métiers du livre » : l’imprimeur se consacre uniquement à l’impression, le libraire à la vente, le papetier à la fabrication du papier, tandis que la fonction éditoriale, devenue un métier à part entière à partir de 1830, domine par sa position stratégiquement centrale les autres métiers du livre et l’auteur. Mais c’est avant tout l’intensification de l’alphabétisation et la multiplication des écoles sur tout le territoire qui sont à l’origine du décollage de l’éditeur au sens moderne du mot. Les premiers best-sellers furent en effet les livres scolaires avec, dès 1830, des millions d’exemplaires vendus. C’est à ce moment que les grands éditeurs vont se développer, et tout particulièrement Louis Hachette dont la société dominera, pendant presque deux siècles, le monde de l’édition en France.
Le XIXe siècle est aux yeux de Jean-Yves Mollier le grand siècle de l’édition, siècle du roman, des dictionnaires avec l’affrontement Larousse-Hachette, du développement des cabinets de lecture, puis des bibliothèques, sans oublier la révolution industrielle permettant des productions en grandes quantités. Les grands éditeurs, largement décrits, souvent très riches, se partagent entre leur passion entrepreneuriale et culturelle et une vie d’apparat dans les salons parisiens.
Jean-Yves Mollier insiste sur l’importance du support : « À l’époque où le roman-feuilleton se logeait au "rez-de-chaussée" du quotidien – le bas de la première page –, les lecteurs d’Alexandre Dumas et d’Eugène Sue découvraient leur écrivain favori dans les pages de leur journal plutôt que dans celles du volume mis en vente en librairie », sur la concurrence sur les prix dont la baisse était devenue nécessaire en raison de la démocratisation du lectorat (prix divisés par dix, par exemple, entre 1838 et 1853) et la modification conséquente des formats d’édition, qui annoncent le « livre de poche » du XXe siècle.
Il insiste aussi sur la capacité des éditeurs français à exporter leurs livres dans le monde entier [2] : « Si la ville de Montevideo a donné à son hospice des enfants trouvés le nom d’Alexandre Dumas et si les cigariers de La Havane ont baptisé "Monte-Cristo" leur plus fameux cigare, c’est bien que le romancier était lu […] sur tout le continent américain et dans toutes les classes sociales. »
Le Premier et le Second Empire ayant rétabli la censure d’Ancien Régime, les écrivains socialisants, ou seulement critiques du régime, durent se faire éditer à l’étranger tandis que les éditeurs pratiquaient une autocensure préventive en refusant des textes, comme le fit Louis Hachette avec Proudhon. Vis-à-vis de la censure religieuse, l’attitude des éditeurs est plus distanciée. Presque tous les grands auteurs du XIXe siècle étaient à l’Index et furent néanmoins publiés. Pour des raisons plus économiques, les éditeurs veillent cependant au respect des bonnes mœurs par leurs écrivains, n’hésitant pas à modifier les textes, comme le fit Calmann-Lévy avec un livre de Pierre Loti (Aziyadé) pour « gommer toutes les allusions à l’homosexualité et à la pédérastie de son personnage ».
Avec la grande loi de 1881, sur la liberté de la presse, la censure est abolie (sauf en quelques cas, « incitation à la haine raciale », « apologie des crimes de guerre », etc.). Jean-Yves Mollier évoque, à propos de la période qui suit, l’avènement de la culture de masse et les rapports, parfois tumultueux, entre les éditeurs et le monde lettré et les avant-gardes, l’importance des revues dans la vie littéraire (NRF, Mercure de France), la suprématie du roman, à l’aube du XXe siècle, avec l’apparition des prix littéraires, « Goncourt en 1903 et Femina-Vie Heureuse en 1904. Leur création semble mettre un point final à la structuration du champ littéraire autour des grandes maisons d’édition, Librairie Hachette, Calmann-Lévy, Charpentier-Fasquelle, Garnier frères, Plon, Hetzel, auxquelles Flammarion et Fayard se sont ajoutées et où Albin Michel, […] et Bernard Grasset […] ont bien l’intention de se faire un nom ».
Au début du XXe siècle, l’auteur souligne la domination d’Hachette et de Larousse sur l’édition française, leur rivalité pour la maîtrise de la distribution dont Hachette sortira vainqueur, mais aussi l’apparition, en marge de l’édition scolaire, d’une littérature pour la jeunesse (où s’affrontent sans merci Mickey et Cœurs vaillants) qui ne cessera de se développer jusqu’à nos jours.
Il décrit enfin l’état de l’édition à la fin du siècle dernier, concentration et financiarisation qui ont déjà été largement commentées dans les prestigieuses colonnes d’Acrimed, ici, ici, et là, qu’il présente comme un secteur éditorial à deux visages correspondant au concept d’ « oligopole à franges », l’un de ces visages étant celui des grands groupes, l’autre celui de la multitude de petits et moyens éditeurs indépendants.
En conclusion, Jean-Yves Mollier plaide pour un maintien du rôle de l’éditeur en tant que découvreur, malgré l’empire grandissant des GAFA (Google, Amazon, FaceBook, Apple), dans un univers éditorial en voie de transformation complète.
Une autre image de l’éditeur
Si Jean-Yves Mollier manifeste sans ambiguïté son adhésion à la fonction de l’éditeur, « celui sans lequel les textes ne deviendraient jamais des livres », son estime pour les éditeurs de chair et d’os est beaucoup plus nuancée. Même s’il reconnaît à des personnages comme Joseph Panckoucke ou Louis Hachette d’incontestables qualités d’entrepreneurs, à d’autres un courage certain : Étienne Dolet, qui fut brûlé vif, Les éditions de Minuit, nées de la résistance, et quelques autres, il ne peut que constater, tout au long de cette histoire de l’édition, l’allégeance constante des éditeurs aux pouvoirs en place.
Ainsi, à la fin de l’Empire : « Les imprimeurs et les libraires accueillaient Louis XVIII avec une ferveur identique à celle qu’ils avaient mise à célébrer le culte de l’empereur déchu. » Et ultérieurement : « Même si Maurice Lachâtre, Pierre Larousse et quelques autres s’écartent de ce modèle, les instances corporatives, Cercle de la Librairie, depuis 1847, puis Syndicat national de l’édition à partir de 1891, collaboreront généralement sans état d’âme avec les pouvoirs publics. Le rétablissement de la censure, en août 1914 puis en septembre 1939, ne posera pas plus de problème que le maintien du corps des commissaires-inspecteurs de la Librairie n’en avait soulevé de 1811 à 1881. Habitués depuis François Ier à obéir ou à se plier aux injonctions du pouvoir politique, les professionnels avaient développé un « habitus » de servilité à l’égard de celui-ci qui pèsera lourd quand l’heure sera venue d’accepter ou de refuser le diktat des autorités d’occupation allemande. » Allégeance au pouvoir qui peut devenir franchement réactionnaire en temps de troubles : « Lors de la Commune de Paris, la plupart des éditeurs quittèrent la ville et participèrent sans état d’âme au lynchage médiatique qui suivit son écrasement [3]. » Quant à leur attitude au cours de la dernière guerre, elle est sans ambiguïté : « Tous avaient expurgé leurs catalogues avant même que les Allemands ne les y invitent », à l’exception unique de Mlle Boiteau, gérante de la librairie Payot de Paris, qui refusa de confier sa liste aux autorités d’occupation. Mais tous les autres, Bernard Grasset en tête qui se flattait que dans sa généalogie « si haut que l’on remonte dans les deux branches, on ne peut trouver un juif ou une juive », devancèrent la censure nazie. On sait que non seulement ils ont licencié leurs personnels juifs sur ordre des Allemands [4], mais aussi qu’ils se sont livrés au pillage en règle des éditions Calmann-Lévy, fermées par l’occupant pour cause de judéité de leur propriétaire.
L’éditeur découvreur de talents, intellectuel passionné de littérature, est une image d’Épinal qui, si elle n’est pas sans aucun fondement, subit tout de même de sérieuses retouches au cours de cette « autre histoire de l’édition ».
Jean Pérès