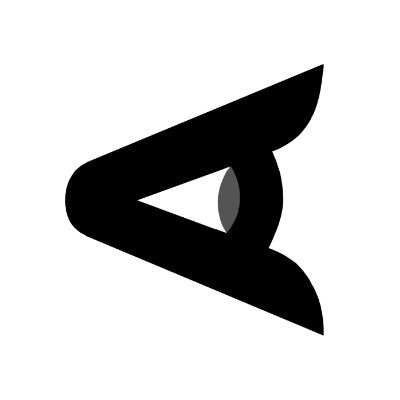Des écoles de journalisme aux rédactions des grands médias, le racisme sévit et reste tabou. Dans l’enquête du SNJ-CGT rendue publique fin mars 2023 [2] et menée auprès de 167 professionnels des médias, un sur quatre déclare avoir été victime de racisme et près d’un sur deux en avoir été témoin. Le SNJ-CGT dénonce « un silence [...] se traduisant par des "non-dits" ou "non-formulés" », tout comme le manque d’espace et d’écoute pour évoquer ces faits de discrimination : « Lorsque les victimes en parlent à leur hiérarchie ou aux élus du CSE, la situation évoluerait si peu que ce recours est perçu comme inutile, ce qui peut démobiliser les victimes qui tentent de se défendre. » La « faible diversité » des rédactions fait partie des explications avancées par le syndicat.
Parallèlement, qu’ils émanent de préjugés ou qu’ils se traduisent par des discours frontalement racistes, des expressions et des contenus discriminants sont proférés dans les médias dominants, excédant de loin les frontières du groupe Bolloré, celles de la presse réactionnaire – Valeurs actuelles en tête – ou celles de la fachosphère, qui en restent néanmoins les vitrines les plus violentes. S’agissant du journalisme politique, rappelons simplement que le traitement dépolitisé et peopolisé du RN, accélérant de manière continue sa prétendue « dédiabolisation » depuis le début des années 2010, est un symptôme en soi de la banalisation du racisme et de la xénophobie. Et ce sans parler de la complaisance multiforme dont firent preuve la plupart des commentateurs à l’égard d’Éric Zemmour – multirécidiviste en matière de provocations à la haine ou d’injures racistes.
Enfin, soulignons que les sites et médias d’extrême droite servent régulièrement de caisse de résonance aux campagnes et coups de forces menés par divers groupuscules, élus et politiciens d’extrême droite – quand ils n’y participent pas directement. Dans sa tribune originelle, l’AJAR rappelle ainsi qu’« en février, des journalistes du Poher, hebdomadaire breton, ont été visés par des menaces de mort et une alerte à la bombe après des articles sur un projet d’accueil de réfugié·e·s. Un billet antisémite sur un site d’extrême droite commente la supposée judéité de deux journalistes de la rédaction, avant de les qualifier de "collabos", puisqu’iels soutiendraient "l’invasion migratoire". » Citons encore l’alerte de l’association Utopia 56 qui, le 17 mai 2023, dénonçait encore les pressions du groupuscule d’extrême droite « Les natifs » contre une école désaffectée à Paris « où survivent plus de 400 jeunes étrangers isolés » : « Ces violences sont avant tout le résultat d’une campagne haineuse et diffamatoire de certains médias et personnalités d’extrême droite, une situation semblable aux épisodes récents de Saint-Brévin, de Mayotte et de Callac », déplorait l’association, avant de pointer Valeurs actuelles ou CNews, amplificateurs de ces discours haineux.
« C’est évident qu’on fait face à quelque chose de beaucoup plus grand que soi... »
Racisme dans les rédactions, contenus racistes... C’est sur ces différents fronts que l’AJAR entend mener la lutte et organiser la colère. En seulement deux mois d’existence, l’association compte près de 200 membres, étudiants en journalisme ou travaillant dans des rédactions très variées, qu’il s’agisse de médias indépendants ou de la presse mainstream (Libération, Le Monde, France Télévisions, Radio France, etc.), et dont la majorité ont entre 25 et 35 ans. « L’objectif, c’était de briser l’isolement et là, on voit que groupés, on pèse et on représente vraiment quelque chose, se réjouit Rémi-Kenzo Pagès. On est seuls dans nos rédactions, mais on n’est pas si seuls dans le métier ! » Un enthousiasme que partage Estelle Ndjandjo, qui précise que l’AJAR refuse l’adhésion de « gros influenceurs », dont le travail s’éloigne du journalisme, ou de professionnels occupant le haut des hiérarchies éditoriales, « rédacteurs en chef ou directeurs de rédaction » notamment, de manière à enrayer structurellement toute « limitation au niveau de la liberté de ton ou de parole » au sein de l’association. Chez les membres de l’AJAR, nombre de mythes journalistiques, qui fondent depuis plusieurs décennies l’imaginaire commun de la profession, ont fait long feu : « Cette espèce de positionnement autour de la neutralité journalistique, c’est du pipeau », martèle Estelle Ndjandjo, qui incarne en ce sens un renouvellement d’une partie des jeunes journalistes, davantage politisés et pour lesquels le « militantisme » n’est pas un gros mot. « Nous sommes une génération qui va plus avoir le cran de parler de l’injustice dans laquelle on vit », constate-t-elle, sans pour autant sous-estimer les réticences à s’engager, dont témoignent en off certains journalistes marqués par le poids du « racisme internalisé » : « Quand tu as passé des années à essayer de creuser ton trou, tu as peur de sauter parce qu’au final, on reste des gens "tolérés". »
L’AJAR entrevoit dès lors deux terrains principaux d’action. D’une part, la mise en lumière des biais racistes à l’œuvre dans le journalisme. « On est débordés ! », s’exclame Rémi-Kenzo Pagès, qui souligne la multiplication des signalements reçus sur les réseaux sociaux, dont certains ont pu être traités et fait l’objet de publications sur le compte Twitter de l’association. Parmi celles-ci, la critique de choix iconographiques révélant des confusions fréquentes entre deux personnalités noires – Midi Libre « choisi[ssant] une photo de l’acteur William Nadylam à l’annonce du décès du comédien Adama Niane », par exemple –, de « propos racistes anti-gitans » tenus dans une émission d’Éric Brunet sur LCI, ou encore l’épinglage d’un reportage de La Charente Libre « compil[ant] la quasi-totalité des préjugés et amalgames racistes existant sur les communautés chinoises et asiatiques », introduit en Une par ce gros-titre : « Des Chinois derrière nos bureaux de tabac » (21/04). Parallèlement, Estelle Ndjandjo dénonce les œillères des médias dominants quant aux vécus des personnes racisées, essentiellement donnés à voir par les médias dits « communautaires » : « [Chez Bissai Média, par exemple], ils arrivent, de manière intelligente, humaine et sensible, à apporter des sujets en donnant la parole à différentes générations : interroger le rapport avec le mot "racisé", avec la langue de tes parents, [ta place et tes expériences] dans l’espace public, comment tu as vécu ton coming-out en tant que personne musulmane, etc. Ce sont des questions qui passent totalement à la trappe dans les médias mainstream », souligne-t-elle avant de déplorer le « décalage total » que créent ces angles morts, en particulier quand ces derniers se doublent d’un traitement mutilé des questions migratoires, charriant « un vocable et un imaginaire négatifs » et véhiculant des « schémas toxiques ». Rémi-Kenzo Pagès boucle la boucle en soulignant d’ailleurs combien des sites comme Bissai Média ou Africultures « sont invisibilisés voire totalement ignorés au sein de la profession ».
La lutte contre le racisme dans les rédactions est le deuxième versant de l’activité de l’AJAR. « L’isolement des journalistes racisés dans les rédactions pose la question de la reproduction sociale dans la profession et des limites structurelles [qu’elle instaure] elle-même pour empêcher l’accès à ce métier », avance Rémi-Kenzo Pagès, qui pointe l’« entre-soi d’un milieu bourgeois, blanc et très parisien », entretenu par un certain nombre de dispositifs qu’« il faut réussir à abattre, un à un. » Dès lors, la problématique du recrutement s’impose comme une évidence pour l’association, qui se fixe pour objectif de réaliser des formations dans les écoles de journalisme – elle est aujourd’hui en lien avec neuf d’entre elles. Reste que, comme l’explique Estelle Ndjandjo, le défi est titanesque : « Quand on voit, par exemple, qu’une étudiante qui porte le foulard est refusée dans tous ses stages, qu’une directrice essaie de pousser, mais que même ça, ce n’est pas suffisant, c’est évident qu’on fait face à quelque chose de beaucoup plus grand que soi... »
C’est l’une des raisons pour lesquelles l’alliance avec les syndicats de journalistes – seuls le SNJ-CGT et le SNJ accompagnent pour l’instant la démarche de l’association – ou avec d’autres collectifs journalistiques (de pigistes, pour l’égalité de genre, etc.), a été dès le début entrevue comme une nécessité. Reproduction sociale dans la profession, concentration du pouvoir éditorial, précarisation, droit du travail, etc. : la lutte contre les discriminations se joue sur bien des fronts et fait l’objet de revendications partagées par d’autres acteurs attachés à bousculer l’ordre des médias dominants, au rang desquels figure évidemment Acrimed. « Tout est à faire, lance Estelle Ndjandjo. Si on est là, c’est parce que d’autres ont pavé le chemin avant nous. Le Bondy Blog, Rokhaya Diallo, qui a tout porté sur ses épaules en se prenant des shit-storms [vagues de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, NDLR], et puis d’autres dans les années 2000 et 2010, qui ont essayé de débloquer ce débat petit à petit. Ils nous ont permis, un, de croire qu’on pouvait être journaliste, et deux, de nous rassembler aujourd’hui. »
Évidemment, la question du mouvement social (antiraciste et de lutte contre les discriminations) se pose avec acuité : si l’on opère un parallèle avec la question des violences sexistes et sexuelles, les bouleversements – certes relatifs et fragiles – survenus dans le champ et les productions journalistiques à ce sujet se sont produits grâce au mouvement MeToo et à la faveur d’un regain des luttes féministes. « Aux États-Unis, rappelle Rémi-Kenzo Pagès, il y a eu un début de mobilisation dans les rédactions suite à "Black Lives Matter", certaines se sont mises en grève sur la question du racisme. Au Philadelphia Inquirer par exemple, il y a une grève des journalistes noirs et des mouvements ont pointé la division raciale du travail journalistique. » Une déflagration que n’a pas connue la France : malgré la mobilisation de longue haleine de collectifs des quartiers populaires et les manifestations importantes qui ont eu lieu à l’été 2020 sous l’impulsion du comité Adama, force est de constater qu’un vaste front de lutte antiraciste fait encore défaut.
En attendant, l’AJAR se lance déterminée dans un travail de fourmi, à la fois vers l’extérieur, mais également dans l’association elle-même – Rémi-Kenzo Pagès parle d’une « construction politique et [d’une] identité en train de se faire » –, en s’autoformant avec l’aide de chercheurs, militants et journalistes. C’est précisément le sens qui fut donné à la réunion publique du 5 mai, acte de naissance de l’AJAR. Son succès témoigne de l’urgence du sujet : plus de quatre cents personnes se sont rassemblées à Paris, dont de très nombreux étudiants en journalisme.
« Il y a un interdit a priori sur les questions de racisme »
Deux tables rondes précèdent les festivités. La première, dédiée au traitement médiatique des questions raciales, réunit David Perrotin, journaliste à Mediapart, et Marie-France Malonga, sociologue, anciennement membre du conseil scientifique du CSA où elle fut la co-autrice du premier rapport « Présence et représentation des minorités visibles à la télévision française ». Regardant dans le rétroviseur des deux dernières décennies, cette dernière rappelle les croyances racistes ayant marqué la profession – « "Mettre un noir à l’antenne, ça fait chuter l’audimat et les gens fuient leurs téléviseurs". [...] C’était vraiment ce qui avait été dit par certains producteurs [...] et quelque chose que l’on entendait beaucoup à la fin des années 1990 et jusqu’au début des années 2000 » –, comme l’héritage des discriminations : « Pendant des années, les journalistes issus des minorités ou racisés avaient du mal à travailler avec leur propre nom : on leur demandait de franciser leurs noms », se souvient-t-elle avant de citer l’exemple de Rachid Arhab dans les années 1980. Si la chercheuse salue à plusieurs reprises des actions et de nettes avancées au fil des décennies, elle constate qu’il reste « beaucoup de verrous à faire sauter », critiquant notamment les représentations audiovisuelles étriquées dans lesquelles sont enfermées les personnes racisées, oscillant entre « la figure de la victime », celle « de la menace, c’est-à-dire l’individu non blanc qui est vu comme un délinquant, une personne qui trouble l’ordre social », des « représentations très exotiques, [...] insistant sur les différences, le folklore, etc. pour induire indirectement que l’individu n’est pas assimilable dans la société française », ou encore « les rôles de second plan, "le second couteau" ».
De son côté, David Perrotin dénonce un « interdit a priori sur les questions de racisme » dans les productions médiatiques : « Un correspondant aux États-Unis [pourra titrer] : "Un noir tabassé par des policiers". Ça ne pose aucune difficulté de poser les termes et [dans l’article], vous allez retrouver le terme "racisme". Vous allez avoir la même la même chose en France [et] si vous avez de la chance, ce sera mis entre guillemets [...] et on va vraiment le traiter a minima. [Mais] comme c’est le plus souvent le cas, on va occulter cet aspect-là. » Avant d’interroger d’autres réflexes journalistiques délétères, en particulier lorsque s’imbriquent racisme et violences policières.
Si Marie-France Malonga soulève le problème de l’autocensure, elle corrélait d’emblée les biais journalistiques et « l’impensé du racisme » au poids de l’idéologie dominante : « L’idée n’est pas de caricaturer en disant que tout le monde est raciste, ça n’a absolument aucun sens bien entendu, mais nous sommes quand même le fruit d’une histoire coloniale et esclavagiste qui a racialisé un certain nombre d’individus. Nous sommes la résultante de ça, donc on ne peut pas [l’] effacer [...]. Les médias, les responsables des médias sont dans ce contexte-là. » Et d’ajouter : « Il y a toujours une forme de malaise à évoquer cette question et dès qu’il y a une revendication, une dénonciation des inégalités, elle va être décriée et considérée comme communautariste. » Une décrédibilisation a priori du message... et du messager, perçu « comme un militant avant d’être [un] journaliste. » Une « présomption de militantisme » insiste-t-elle, que dénonce également David Perrotin en s’appuyant sur son parcours dans certaines rédactions, « notamment celles d’hebdomadaires assez connus », où il est « très compliqué [...] de percer le poids et le mur du soupçon » dès lors que les sujets proposés ont trait « au racisme, à l’islamophobie » mais aussi aux « questions des LGBTI phobies ».
Le climat politique actuel est évidemment abordé, qu’il s’agisse de la stigmatisation du combat antiraciste, « affublé de [qualificatifs comme] "wokiste" ou "indigéniste" », ou de l’enracinement électoral de l’extrême droite, carburant d’une « réaction raciste qui s’exprime au quotidien » pour David Perrotin, qui rappelle à ce sujet les « affaires » Maryam Pougetoux ou Menel, avant de pointer du doigt « plein de médias mainstream » n’ayant pas le réflexe de se dire, par exemple, que « lorsqu’une femme voilée est victime d’un élu RN dans un conseil régional, on ne va pas stigmatiser la victime pendant une semaine ! » Pour le journaliste, « l’aspect systémique des discriminations et du racisme » implique dès lors de nécessaires « réorganisations des rédactions », notamment à travers une « rubrique "discrimination" spécifique » ou des « interrogations sur le recrutement et la représentation des personnes racisées dans les rédactions », constat partagé par Marie-France Malonga.
Diversité des rédactions, pouvoir éditorial
C’est précisément cette question qu’abordent, dans la seconde table ronde, Ekia Badou, journaliste à Voice of America Afrique et Helena Berkaoui, rédactrice en chef du Bondy Blog. Toutes deux font état des préjugés et des commentaires racistes subis au cours de leurs carrières [3]. Chargée de témoignages, Ekia Badou cite « l’environnement nauséabond » d’une rédaction pour laquelle elle présenta les journaux de nuit, l’expérience d’une amie qui « ne cachait pas sa religion [musulmane] [...] et était pratiquante d’une façon jugée extrême par ses collègues de Radio France » [4], l’insistance de confrères « qui ne voient que [la couleur] [...] et me le rappellent toujours : "Tu es d’où ? / [...] Du 10e arrondissement. / Non mais bon, d’où ?" », ou encore une consœur s’adressant à elle au cours d’un reportage : « C’est un oncle à toi Amin Dada ? » Et ce sans parler du poids des assignations éditoriales :
Ekia Badou : Dans les médias généralistes où j’ai commencé à travailler, [...] on me cantonnait toujours à une image que je ne comprenais pas, c’est-à-dire qu’on proposait des sujets [pour lesquels] il fallait aller en banlieue. C’était tout de suite : « On a Ekia, c’est super, c’est Ekia qui va aller en banlieue ! » [...] Je me disais que peut-être, c’était des malentendus, les gens ne se rendent pas compte que c’est très cliché, et je faisais ce qu’on me demandait de faire en me disant : « Bon, t’as ton poste, sois contente, t’es pigiste, fais tes preuves. » Et ça a duré comme ça pendant 3 ans où à chaque fois, on me parlait « banlieue » ou « Afrique ».
Un phénomène que confirme Helena Berkaoui : « On m’a beaucoup donné de sujets qui étaient en lien avec l’islam [...] sans que je les demande par ailleurs. Il y avait une forme de double contrainte : à devoir prendre ces sujets-là, mais aussi à être un peu en proie à une suspicion [quant à] mon objectivité à les traiter. » Injonctions contradictoires, « brimades » ou « accrochages » d’autant plus difficiles à contrer ou simplement à rapporter « quand vous êtes précaire, quand vous êtes pigiste, insiste-t-elle. Quand vous ne savez pas si on va vous rappeler ou pas et que de ça va dépendre ce que vous avez dans le frigo. [...] Vous y réfléchissez à deux fois. »
Source de mal-être au travail, ces contraintes économiques entravent également le positionnement des journalistes vis-à-vis des lignes et des directives éditoriales, certes très peu contestées... mais difficilement contestables : « [En conférence de rédaction], ça peut être assez compliqué voire complètement impossible d’imposer certaines idées », poursuit la rédactrice en chef du Bondy Blog. Reste que les deux journalistes posent frontalement la question du pouvoir éditorial au cours des échanges. L’une, Ekia Badou, pour décrire comment les biais racistes peuvent survenir du fait d’ingérences de rédacteurs en chef, intervenant par exemple sur le script d’un reportage auquel ils n’ont jamais participé. L’autre, Helena Berkaoui, dans l’optique de réfléchir aux perspectives à porter pour secouer le champ journalistique. « La question du recrutement doit être pensée sur le long terme » et au-delà, « il faut [...] des politiques suivies, continues [et qui posent] la question de qui est où, donc à quelle place dans la rédaction. Est-ce que les évolutions de carrière sont les mêmes que l’on soit un homme blanc ou une femme non blanche ? [...] C’est indispensable que ce ne soit pas des effets de mode. [...] Prenons la une [5] a déjà suffisamment bien documenté ça : le journalisme, c’est une profession [précarisée], donc qui s’est féminisée. Et quand on regarde qui il y a à la tête des rédactions, eh bien souvent, ce sont des hommes blancs. »
Malgré la vivacité des échanges et le succès de ce lancement public, la soirée n’a pas été couverte dans les médias dominants. « Les gens font comme si on n’existait pas, soupire Rémi-Kenzo Pagès. Je pense que ça bouscule aussi beaucoup de choses chez eux puisqu’on est nés sur une critique de la profession. Pour l’instant, on a eu plutôt de bons retours. [...] Rien de malveillant nous disant qu’on n’était pas légitimes à faire ces critiques, [même si] de manière souterraine, beaucoup de personnes le pensent... » Courage et longue vie à l’AJAR !
Pauline Perrenot